Moment décisif d’une intrigue, la scène de première rencontre est aussi un moment attendu de la part du lecteur, un topos littéraire, un lieu commun. Écrire une scène de première rencontre, c’est donc, pour un écrivain, se positionner par rapport aux modèles du genre. Pour le dire autrement, une tradition de la scène de première rencontre s’est construite au fil de l’histoire littéraire. De Madame de la Fayette à Roger Peyrefitte en passant par Flaubert, je vous invite donc aujourd’hui à découvrir quelques unes de ces scènes de première rencontre, devenues mythiques.
1. La Princesse de Clèves (Mme de La Fayette)
Commençons avec un grand classique. Ce roman a connu une publicité involontaire en 2006, lorsque le candidat Nicolas Sarkozy, dans un discours, s’en est moqué, le jugeant déconnecté des réalités d’aujourd’hui, et suscitant la colère de tous les amoureux de littérature. La princesse de Clèves, paru en 1678, est en effet un chef d’œuvre de la littérature classique, un monument du roman psychologique, qui a posé des jalons essentiels pour toute la littérature romanesque qui a suivi. Ce roman, attribué à Madame de la Fayette, conte les amours impossibles de la Princesse de Clèves et du Duc de Nemours. La scène de première rencontre est évidemment un moment crucial de l’intrigue. Elle a lieu lors d’un bal donné par le roi et la reine en personne.
Il arriva la veille des fiançailles ; et dès le même soir qu’il fut arrivé, il alla rendre compte au roi de l’état de son dessein, et recevoir ses ordres et ses conseils pour ce qui lui restait à faire. Il alla ensuite chez les reines. Madame de Clèves n’y était pas, de sorte qu’elle ne le vit point, et ne sut pas même qu’il fût arrivé. Elle avait ouï parler de ce prince à tout le monde, comme de ce qu’il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour ; et sur-tout madame la dauphine le lui avait dépeint d’une sorte, et lui en avait parlé tant de fois, qu’elle lui avait donné de la curiosité, et même de l’impatience de le voir.
Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisaient au Louvre. Lorsqu’elle arriva, l’on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença ; et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu’un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser ; et, pendant qu’elle cherchait des yeux quelqu’un qu’elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna, et vit un homme qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelque siége pour arriver où l’on dansait. Ce prince était fait d’une sorte qu’il était difficile de n’être pas surprise de le voir, quand on ne l’avait jamais vu ; sur-tout ce soir-là, où le soin qu’il avait pris de se parer augmentait encore l’air brillant qui était dans sa personne : mais il était difficile aussi de voir madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement.
M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté, que, lorsqu’il fut proche d’elle, et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s’ils n’avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s’ils ne s’en doutaient point. Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n’ai pas d’incertitude ; mais, comme madame de Clèves n’a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j’ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, qu’elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine ; et il y a même quelque chose d’obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l’avoir jamais vu. La reine les interrompit pour faire continuer le bal : M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d’une parfaite beauté, et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu’il allât en Flandres ; mais, de tout le soir, il ne put admirer que madame de Clèves.
Le chevalier de Guise, qui l’adorait toujours, était à ses pieds, et ce qui se venait de passer lui avait donné une douleur sensible. Il prit comme un présage que la fortune destinait M. de Nemours à être amoureux de madame de Clèves : et, soit qu’en effet il eût paru quelque trouble sur son visage, ou que la jalousie fît voir au chevalier de Guise au delà de la vérité, il crut qu’elle avait été touchée de la vue de ce prince, et.il ne put s’empêcher de lui dire que M. de Nemours était bien heureux de commencer à être connu d’elle par une aventure qui avait quelque chose de galant et d’extraordinaire.
Madame de Clèves revint chez elle, l’esprit si rempli de tout ce qui s’était passé au bal, que, quoiqu’il fût fort tard, elle alla dans la chambre de sa mère pour lui en rendre compte ; et elle lui loua M. de Nemours avec un certain air qui donna à madame de Chartres la même pensée qu’avait eue le chevalier de Guise.
Le lendemain, la cérémonie des noces se fit. Madame de Clèves y vit le duc de Nemours avec une mine et une grace si admirables qu’elle en fut encore plus surprise.
Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, cité d’après l’édition Lepetit de 1820 en orthographe moderne (Wikisource)
Il serait trop long de faire un commentaire en bonne et due forme de cet extrait, mais on peut cependant relever la façon qu’a Madame de La Fayette de présenter la première rencontre comme extraordinaire. L’entrée des deux personnages est remarquée de tous. Nos deux protagonistes ne passent pas inaperçu. Et ils tombent l’un sur l’autre avec un hasard qui ressemble beaucoup au destin. La conversation avec le roi et la reine montre qu’ils se sont immédiatement reconnus sans avoir eu besoin de se présenter. Ce que nous venons de lire là, c’est l’un des coups de foudre les plus célèbres de la littérature française.
2. La Nouvelle-Héloïse (Rousseau)
Passons au XVIlle siècle, avec La Nouvelle-Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui est sans doute l’un des plus grands romans de son siècle. Bien sûr, s’agissant d’un roman épistolaire, nous n’avons pas le récit d’un narrateur extradiégétique sur la scène de première rencontre. C’est à travers leurs lettres que l’on reconstruit la première rencontre entre Julie et son précepteur Saint-Preux. Voici le point de vue de Saint-Preux, tel qu’il le formule dans sa lettre à Julie, vers le début du roman :
Vous savez que je ne suis entré dans votre maison que sur l’invitation de madame votre mère. Sachant que j’avais cultivé quelques talents agréables, elle a cru qu’ils ne seraient pas inutiles, dans un lieu dépourvu de maîtres, à l’éducation d’une fille qu’elle adore. Fier, à mon tour, d’orner de quelques fleurs un si beau naturel, j’osai me charger de ce dangereux soin, sans en prévoir le péril, ou du moins sans le redouter. Je ne vous dirai point que je commence à payer le prix de ma témérité : j’espère que je ne m’oublierai jamais jusqu’à vous tenir des discours qu’il ne vous convient pas d’entendre, et manquer au respect que je dois à vos mœurs encore plus qu’à votre naissance et à vos charmes. Si je souffre, j’ai du moins la consolation de souffrir seul, et je ne voudrais pas d’un bonheur qui pût coûter au vôtre.
Cependant je vous vois tous les jours, et je m’aperçois que, sans y songer, vous aggravez innocemment des maux que vous ne pouvez plaindre, et que vous devez ignorer. Je sais, il est vrai, le parti que dicte en pareil cas la prudence au défaut de l’espoir ; et je me serais efforcé de le prendre, si je pouvais accorder en cette occasion la prudence avec l’honnêteté ; mais comment me retirer décemment d’une maison dont la maîtresse elle-même m’a offert l’entrée, où elle m’accable de bontés, où elle me croit de quelque utilité à ce qu’elle a de plus cher au monde ? Comment frustrer cette tendre mère du plaisir de surprendre un jour son époux par vos progrès dans des études qu’elle lui cache à ce dessein ? Faut-il quitter impoliment sans lui rien dire ? Faut-il lui déclarer le sujet de ma retraite, et cet aveu même ne l’offensera-t-il pas de la part d’un homme dont la naissance et la fortune ne peuvent lui permettre d’aspirer à vous ?
Ces deux paragraphes, situés au début du roman, montrent l’émotion de Saint-Preux, son trouble face à Julie, et sa conscience très lucide du fait que, en raison de leur différence sociale, ils ne pourraient être ensemble, quand bien même ils se plairaient. Saint-Preux fait état d’une situation aporétique : il ne peut ni laisser s’exprimer ses sentiments, ni les fuir en quittant son emploi de précepteur. Son langage traduit sa réflexion, ses doutes, son intelligence, sa moralité, mais aussi son désir de faire bonne impression à Julie. La réponse de Julie (plus loin dans le roman) montrera qu’elle aussi n’est pas indifférente au charme de Saint-Preux. Cependant, conformément à son rang, elle épousera M. de Wolmar. Dès la première rencontre, la relation est présentée comme impossible. Ce thème de l’amour impossible a quelque chose de tragique (puisque c’est une situation sans issue, dont la fin sera fatalement malheureuse), et en même temps de romantique (avec des personnages torturés, aux émotions exacerbées). Si vous ne connaissez pas ce roman, courez vous le procurer, c’est l’un des plus beaux romans du XVIIIe siècle.
3. Les Chouans (Balzac)
Les Chouans est l’un des premiers romans de Balzac à connaître le succès. Publié en 1829, ce roman de Balzac, qui s’inscrit dans le vaste projet de la Comédie humaine, s’inspire de faits qui ont eu lieu trente ans plus tôt, en Bretagne, à savoir l’insurrection des Chouans, royalistes, opposés au pouvoir républicain (je rappelle que, en 1799, la France était gouvernée par le Directoire). Parmi les nombreux personnages de ce roman, il y a l’espionne Marie de Verneuil, qui travaille pour le pouvoir républicain avec une mission d’infiltration chez les Chouans, et le Marquis de Montauran, surnommé le Gars, qui est le chef des Chouans. L’histoire d’amour des deux personnages se construit donc avec, en toile de fond, cette guerre civile. Comme chez Madame de la Fayette, il s’agit d’un amour impossible. Autre point commun : les deux personnages se sont rencontrés lors d’un bal.
4. Le Rouge et le Noir (Stendhal)
C’est l’une des plus célèbres pages de la littérature romanesque française que nous nous apprêtons à découvrir. Julien Sorel, jeune, ingénu mais ambitieux, est envoyé comme précepteur dans la famille de Madame de Rênal, plus âgée, mariée et mère de famille. Leur première rencontre constitue évidemment un passage décisif du roman.
Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut près de la porte d’entrée la figure d’un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette.
Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l’esprit un peu romanesque de madame de Rênal eut d’abord l’idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte d’entrée, et qui évidemment n’osait pas lever la main jusqu’à la sonnette. Madame de Rênal s’approcha, distraite un instant de l’amer chagrin que lui donnait l’arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s’avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille :
— Que voulez-vous ici, mon enfant ?
Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu’il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question.
— Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu’il essuyait de son mieux.
Madame de Rênal resta interdite ; ils étaient fort près l’un de l’autre à se regarder. Julien n’avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant, lui parler d’un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes, qui s’étaient arrêtées sur les joues si pâles d’abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d’une jeune fille ; elle se moquait d’elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi, c’était là ce précepteur qu’elle s’était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouetter ses enfants !
— Quoi, monsieur, lui dit-elle enfin, vous savez le latin ?
Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu’il réfléchit un instant.
— Oui, madame, dit-il timidement. – Madame de Rênal était si heureuse, qu’elle osa dire à Julien :
— Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants ?
— Moi, les gronder, dit Julien étonné, et pourquoi ?
— N’est-ce pas, monsieur, ajouta-t-elle après un petit silence et d’une voix dont chaque instant augmentait l’émotion, vous serez bon pour eux, vous me le promettez ?
S’entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si bien vêtue était au-dessus de toutes les prévisions de Julien : dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s’était dit qu’aucune dame comme il faut ne daignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Madame de Rênal de son côté était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu’à l’ordinaire parce que pour se rafraîchir il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie elle trouvait l’air timide d’une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et l’air rébarbatif. Pour l’âme si paisible de madame de Rênal, le contraste de ses craintes et de ce qu’elle voyait fut un grand événement. Enfin elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui.
— Entrons, monsieur, lui dit-elle d’un air assez embarrassé.
De sa vie une sensation purement agréable n’avait aussi profondément ému madame de Rênal, jamais une apparition aussi gracieuse n’avait succédé à des craintes plus inquiétantes.
Le terme d’ « apparition », que nous retrouverons chez Flaubert, marque le caractère presque magique de cette scène de première rencontre. Madame de Rênal, qui craignait que le précepteur de ses enfants fût austère et sévère, est complètement rassurée à la vue de Julien Sorel, dont la jeunesse est constamment rappelée par son portrait physique. La délicatesse de ses traits, la blancheur de son teint, son allure presque féminine contrastent avec ses origines modestes. Julien Sorel, quant à lui, est émerveillé par Madame de Rênal, sans doute parce que c’était la première fois de sa vie qu’il approchait une dame. Elle est bien vêtue, elle sent bon, elle habite une riche maison : toutes ces choses-là sont nouvelles pour Julien.
Il n’y a pas encore en eux l’idée qu’ils pourraient tomber amoureux l’un de l’autre : elle est simplement rassurée par l’apparence du nouveau précepteur, lequel est, quant à lui, simplement impressionné par le fait de rencontrer une personne qui vit dans un bien plus haut milieu social que lui. Cependant, leur gêne, leurs silences, leurs balbutiements, montrent qu’il y a malgré tout entre eux quelque chose en germe, qui n’est pas encore conscient, mais qui ne demande qu’à s’épanouir. Il faudrait relever les marques de cette communication non-verbale qui traduisent leur émoi. Cette émotion est trop forte pour n’être explicable que par la surprise, et c’est ainsi que le lecteur comprend qu’il s’agit d’un coup de foudre.
5. L’Éducation sentimentale (Flaubert)
Là encore, nous nous apprêtons à lire un morceau d’anthologie, les plus belles pages de ce chef d’œuvre qu’est L’Éducation sentimentale de Flaubert. Le titre de ce roman ne m’attirait pas, mais un ami étudiant m’a encouragé à lire ce livre qui a vraiment été une révélation pour moi. C’est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de roman. Si vous voulez lire un livre bien écrit, mais moderne, lisez L’Éducation sentimentale de Flaubert.
Évidemment, Flaubert a de la culture, et il connaît le modèle classique représenté par Madame de la Fayette. Impossible de faire la même chose. Et donc, il va écrire une scène de première rencontre avec beaucoup de recul, de distance critique et d’ironie. Le coup de foudre, idéal, romantique, se produit donc dans un décor qui, lui, n’a rien d’idyllique.
Je me permets de citer un assez long extrait, qui permette de savourer pleinement le passage, même s’il faudrait, pour bien faire, lire le chapitre entier.
Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard.
Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se heurtait ; les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s’absorbait dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, en avant, tintait sans discontinuer.
Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d’usines, filèrent comme deux larges rubans que l’on déroule.
Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms ; puis il embrassa, dans un dernier coup d’œil, l’île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame ; et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir.
M. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s’en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant deux mois, avant d’aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l’avait envoyé au Havre voir un oncle, dont elle espérait, pour lui, l’héritage ; il en était revenu la veille seulement ; et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale, en regagnant sa province par la route la plus longue.
Le tumulte s’apaisait ; tous avaient pris leur place ; quelques-uns, debout, se chauffaient autour de la machine, et la cheminée crachait avec un râle lent et rythmique son panache de fumée noire ; des gouttelettes de rosée coulaient sur les cuivres ; le pont tremblait sous une petite vibration intérieure, et les deux roues, tournant rapidement, battaient l’eau.
La rivière était bordée par des grèves de sable. On rencontrait des trains de bois qui se mettaient à onduler sous le remous des vagues, ou bien, dans un bateau sans voiles, un homme assis pêchait ; puis les brumes errantes se fondirent, le soleil parut, la colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à peu s’abaissa, et il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée.
Des arbres la couronnaient parmi des maisons basses couvertes de toits à l’italienne. Elles avaient des jardins en pente que divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes, et des vases de géraniums, espacés régulièrement sur des terrasses où l’on pouvait s’accouder. Plus d’un, en apercevant ces coquettes résidences, si tranquilles, enviait d’en être le propriétaire, pour vivre là jusqu’à la fin de ses jours, avec un bon billard, une chaloupe, une femme ou quelque autre rêve. Le plaisir tout nouveau d’une excursion maritime facilitait les épanchements. Déjà les farceurs commençaient leurs plaisanteries. Beaucoup chantaient. On était gai. Il se versait des petits verres.
Frédéric pensait à la chambre qu’il occuperait là-bas, au plan d’un drame, à des sujets de tableaux, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l’excellence de son âme tardait à venir. Il se déclama des vers mélancoliques ; il marchait sur le pont à pas rapides ; il s’avança jusqu’au bout, du côté de la cloche ; et, dans un cercle de passagers et de matelots, il vit un monsieur qui contait des galanteries à une paysanne, tout en lui maniant la croix d’or qu’elle portait sur la poitrine. C’était un gaillard d’une quarantaine d’années, à cheveux crépus. Sa taille robuste emplissait une jaquette de velours noir, deux émeraudes brillaient à sa chemise de batiste, et son large pantalon blanc tombait sur d’étranges bottes rouges, en cuir de Russie, rehaussées de dessins bleus.
La présence de Frédéric ne le dérangea pas. Il se tourna vers lui plusieurs fois, en l’interpellant par des clins d’œil ; ensuite il offrit des cigares à tous ceux qui l’entouraient. Mais, ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin. Frédéric le suivit.
La conversation roula d’abord sur les différentes espèces de tabacs, puis, tout naturellement, sur les femmes. Le monsieur en bottes rouges donna des conseils au jeune homme ; il exposait des théories, narrait des anecdotes, se citait lui-même en exemple, débitant tout cela d’un ton paterne, avec une ingénuité de corruption divertissante.
Il était républicain ; il avait voyagé, il connaissait l’intérieur des théâtres, des restaurants, des journaux, et tous les artistes célèbres, qu’il appelait familièrement par leurs prénoms ; Frédéric lui confia bientôt ses projets ; il les encouragea.
Mais il s’interrompit pour observer le tuyau de la cheminée, puis il marmotta vite un long calcul, afin de savoir « combien chaque coup de piston, à tant de fois par minute, devait, etc. ». Et, la somme trouvée, il admira beaucoup le paysage. Il se disait heureux d’être échappé aux affaires.
Frédéric éprouvait un certain respect pour lui, et ne résista pas à l’envie de savoir son nom. L’inconnu répondit tout d’une haleine :
— Jacques Arnoux propriétaire de l’Art industriel, boulevard Montmartre.
Un domestique ayant un galon d’or à la casquette vint lui dire :
— Si Monsieur voulait descendre ? Mademoiselle pleure.
Il disparut.
L’Art industriel était un établissement hybride, comprenant un journal de peinture et un magasin de tableaux. Frédéric avait vu ce titre-là, plusieurs fois, à l’étalage du libraire de son pays natal, sur d’immenses prospectus, où le nom de Jacques Arnoux se développait magistralement.
Le soleil dardait d’aplomb, en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, les plaques du bastingage et la surface de l’eau ; elle se coupait à la proue en deux sillons, qui se déroulaient jusqu’au bord des prairies. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. La campagne était toute vide. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, et l’ennui, vaguement répandu, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l’aspect des voyageurs plus insignifiant encore.
À part quelques bourgeois, aux Premières, c’étaient des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Comme on avait coutume alors de se vêtir sordidement en voyage, presque tous portaient de vieilles calottes grecques ou des chapeaux déteints, de maigres habits noirs râpés par le frottement du bureau, ou des redingotes ouvrant la capsule de leurs boutons pour avoir trop servi au magasin ; çà et là, quelque gilet à châle laissait voir une chemise de calicot, maculée de café ; des épingles de chrysocale piquaient des cravates en lambeaux ; des sous-pieds cousus retenaient des chaussons de lisière ; deux ou trois gredins qui tenaient des bambous à gance de cuir lançaient des regards obliques, et des pères de famille ouvraient de gros yeux, en faisant des questions. Ils causaient debout, ou bien accroupis sur leurs bagages ; d’autres dormaient dans des coins ; plusieurs mangeaient. Le pont était sali par des écales de noix, des bouts de cigares, des pelures de poires, des détritus de charcuterie apportée dans du papier ; trois ébénistes, en blouse, stationnaient devant la cantine ; un joueur de harpe en haillons se reposait, accoudé sur son instrument ; on entendait par intervalles le bruit du charbon de terre dans le fourneau, un éclat de voix, un rire ; et le capitaine, sur la passerelle, marchait d’un tambour à l’autre, sans s’arrêter. Frédéric, pour rejoindre sa place, poussa la grille des Premières, dérangea deux chasseurs avec leurs chiens.
Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent, derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l’air bleu.
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre ; puis il se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait d’observer une chaloupe sur la rivière.
Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu’elle avait portées, les gens qu’elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas de limites.
Une négresse, coiffée d’un foulard, se présenta, en tenant par la main une petite fille, déjà grande. L’enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s’éveiller. Elle la prit sur ses genoux : « Mademoiselle n’était pas sage, quoiqu’elle eût sept ans bientôt ; sa mère ne l’aimerait plus ; on lui pardonnait trop ses caprices. » Et Frédéric se réjouissait d’entendre ces choses, comme s’il eût fait une découverte, une acquisition.
Il la supposait d’origine andalouse, créole peut-être ; elle avait ramené des îles cette négresse avec elle ?
Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s’en couvrir les pieds, dormir dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il allait tomber dans l’eau ; Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit :
— Je vous remercie, monsieur.
Leurs yeux se rencontrèrent.
— Ma femme, es-tu prête ? cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l’escalier.
Il est tout à fait remarquable de voir comment Flaubert joue à inclure la scène de première rencontre dans un décor tout à fait trivial. Il y a de l’agitation, du mouvement, du bruit, de l’ordure, et au milieu de tout cela, le miracle a lieu. « Ce fut comme une apparition » : cette phrase est l’une des plus célèbres du roman français. Le jeune homme est déjà sous le charme de cette femme en robe de mousseline. Madame Arnoux n’a pas remarqué Frédéric, et il faut que son châle manque de tomber à l’eau, et que Frédéric le ramasse, pour qu’ait lieu, comme en un ralenti de cinéma, le premier échange de regards. Là encore, le coup de foudre est immédiat. Mais d’emblée, les paroles du « sieur Arnoux » brisent le romantisme de la scène : sa prise de parole, banale et prosaïque, nous rappelle que Madame Arnoux est déjà mariée, et que cet amour naissant est impossible. Et Flaubert a pris plaisir à nous peindre un Arnoux très beauf, aux antipodes du romantisme de Frédéric.
■ Lire l’article : « L’Éducation sentimentale »
6. Le Grand Meaulnes (Fournier)
Je me souviens avoir étudié en khâgne un extrait de ce roman, qui comprenait une scène de première rencontre. D’après Wikipédia, « le roman est l’œuvre littéraire française la plus traduite et lue dans le monde juste après Le Petit Prince. Il totalisait à la fin du XXe siècle plus de quatre millions d’exemplaires vendus en format de poche. »
Les deux personnages concernés sont Augustin Meaulnes et Yvonne de Galais. J’ai retrouvé le passage sur le site « Bac de Français » :
La vieille dame resta sur la rive, et, sans savoir comment, Meaulnes se trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le grand vent, et il put regarder à l'aise le jeune fille, qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordue.
Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un brui calme de machine et d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelque maison de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu'au soir on entendrait les tourterelles gémir... Mais soudain une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête.
On aborda devant un bois de sapins. Sur le débarcadère, les passages durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eût ouvert le cadenas de la barrière... Avec quel émoi Meaulnes se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille ! Il avait regardé ce profil si pur, de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes. Et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu'elle lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue...
A terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Meaulnes s'avança dans une allée, où, dix pas devant lui, marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir :
"Vous êtes belle", dit-il simplement.
Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient, jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu'il l'aperçut soudain venant à sa rencontre et forcée de passer près de lui dans l'étroit sentier. Elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser.
Cette fois, le jeune homme salua, en disant très bas :
"Voulez-vous me pardonner ?
- Je vous pardonne, dit-elle gravement. Mais il faut que je rejoigne les enfants, puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu".
Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi, qu'elle marcha plus lentement et l'écouta.
"Je ne sais même pas qui vous êtes", dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier... Ensuite elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au loin.
"Je ne sais pas non plus votre nom", répondit Meaulnes.
Ils suivaient maintenant un chemin découvert, et l'on voyait à quelque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la pleine campagne.
"Voici la 'maison de Frantz'", dit la jeune fille ; il faut que je vous quitte..."
Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit :
"Mon nom ?... Je suis mademoiselle Yvonne de Galais..."
Et elle s'échappa.
Alain-Fournier - Le Grand Meaulnes - La rencontre avec Yvonne de Galais
7. À une passante (Baudelaire)
Je trouve intéressant de ne pas limiter nos investigations au seul champ du roman, et d’inclure « À une passante » de Baudelaire. Ce poème des Fleurs du Mal est bien, en effet, une scène de première rencontre, avec comme particularité qu’elle est totalement fortuite, et qu’elle ne dure que quelques secondes.
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair… puis la nuit ! — Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?
Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !
■ Lien vers l’article : « À une passante » de Charles Baudelaire
Ayant déjà consacré un article à ce sonnet qui fait partie des pièces les plus célèbres des Flans du mal, je me bornerai ici à quelques remarques centrées sur la question qui nous préoccupe, à savoir la scène de première rencontre. Décrite dans les quatrains dans toute sa beauté marmoréenne, la femme aimée fascine complètement le poète. Les points d’interrogation et d’exclamation qui abondent dans les versets révèlent le trouble du poète et soulignent le caractère fulgurant de cette première rencontre, qui est en même temps la dernière. L’échange a été très bref, non verbal, mais le dernier vers laisse entendre qu’une forme de communication a malgré tout eu lieu. C’est comme si un instant suspendu, une parenthèse dans la trame du temps, s’ouvrait pour quelques secondes, pour se refermer presque aussitôt, revenant à la normale. Mais, pendant quelques secondes, un univers a existé où les deux personnages s’aimaient.
8. Les Amitiés particulières (Roger Peyrefitte)
J’ai tenu à inclure ce roman afin de rappeler que la première rencontre amoureuse n’a pas toujours lieu entre un homme et une femme. Ce roman, qui n’est pas tout récent (il a été publié en 1943, à une époque où l’homosexualité était encore considérée comme une déviance mentale), évoque l’amour de deux adolescents dans un pensionnat catholique. Les deux jeunes hommes évoluent ainsi dans un climat conservateur et réactionnaire, mais aussi dans un milieu strictement masculin. Le personnage principal, Georges de Sarre, élève de troisième, est d’abord attiré par son camarade Lucien, et se montre jaloux de « l’amitié particulière » que ce dernier entretient avec un élève nommé André. Georges se débrouille pour faire exclure André de l’internat, mais cela ne lui permet pas d’avoir les faveurs de Lucien pour autant. Georges remarque alors, pendant la messe, un élève de cinquième, de deux ans plus jeune que lui, dont la beauté l’émeut particulièrement. Ce dernier, Alexandre, ne le remarque pas à ce moment-là, et c’est ainsi que la scène de première rencontre se fait à sens unique, avec la focale de Georges qui contemple Alexandre.
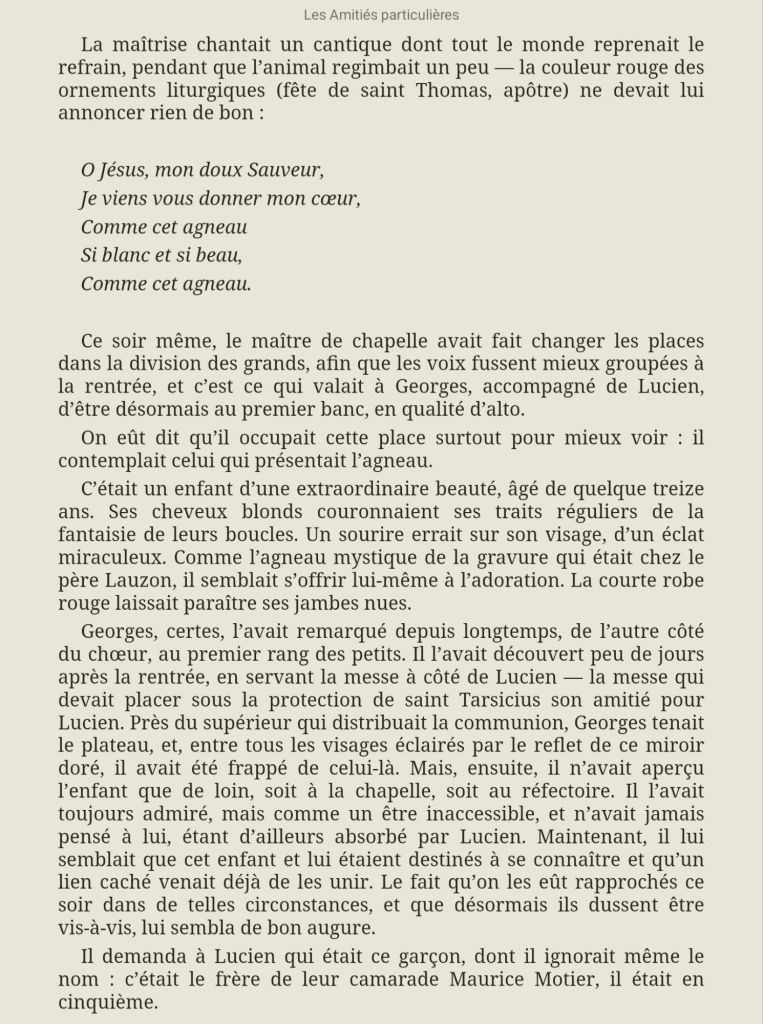
Dans ce roman, la religion catholique est omniprésente. Elle représente l’institution morale qui régente chaque minute du temps des élèves pensionnaires de l’institut Saint-Claude. Mais elle est aussi le cadre, la toile de fond sur laquelle se vivent des amours cachées et interdites, des amours enfantines qui devraient être innocentes, mais que la morale religieuse présente comme coupables. Dans cet extrait, on peut faire un parallèle entre la pureté de l’agneau pascal (un véritable agneau amené pour les célébrations de Pâques) et l’innocence de cet enfant de cinquième, dont on apprendra plus tard qu’il s’appelle Alexandre Motier, petit frère de Maurice Motier.
Ce passage nous présente le portrait physique d’Alexandre. Sa blondeur, ses boucles, son sourire soulignent sa jeunesse. Sa robe, une tenue propre aux célébrations religieuses, accentue son aspect infantile, voire féminin. C’est, en un mot, le portrait d’un enfant, dont est soulignée la douceur, l’angélisme, la pureté. Georges, le personnage principal, n’a d’yeux que pour ce camarade, qui a deux ans de moins que lui. Georges a l’impression que c’est le destin qui les a placés dans l’église de façon à facilement pouvoir se regarder, et il ne cherchera par la suite qu’à se rapprocher de ce séduisant camarade. Alexandre, quant à lui, n’a pas du tout remarqué Georges à ce moment-là.
Ce portrait physique n’a rien d’érotique. Roger Peyrefitte semble avoir voulu sublimer, et comme idéaliser, ces amours enfantines, à la frontière entre amitié et tendresse. Cependant, il est difficile d’oublier que l’auteur est, lui, beaucoup plus âgé que son personnage principal, et l’on est parfois gêné que le désir de Georges se porte sur un camarade plus jeune, qui est parfois appelé « l’enfant ». Je retrouve ici un peu la même gêne que celle que j’ai éprouvée dans L’Immoraliste d’André Gide, par exemple. À nuancer cependant : Georges et Alexandre sont tous deux mineurs, ce qui n’est pas du tout la même chose. Leur relation est bien chaste, et les personnages ne la cultivent guère que parce qu’elle est interdite.
Roger Peyrefitte décrit ainsi l’hypocrisie des pensionnats catholiques d’élite, où la morale religieuse est à ce point étriquée qu’elle implique presque naturellement son contournement. Les professeurs, dès le jour de la rentrée, mettent en garde contre les « amitiés particulières », instillant ainsi dans l’esprit des élèves l’idée même de ce qu’ils prétendaient éviter. Dans cet établissement où un simple poème d’amour peut justifier un renvoi, les élèves vont devoir user de toutes sortes de stratagèmes pour s’aimer en secret.
☆
La scène de première rencontre est un passage clef de bien des romans. Elle est cet instant décisif où les regards se croisent, où l’on se dévisage, où l’on se découvre, et, bien souvent, où se produit le coup de foudre. En un instant, les personnages savent que c’est lui, que c’est elle. On pourrait dire qu’ils se reconnaissent autant qu’ils se rencontrent, comme s’ils se connaissaient depuis toujours. C’est la rencontre idéale de la princesse de Clèves et du duc de Nemours, la gêne timide de Julien Sorel et de Madame de Rênal, la magique apparition de Madame Arnoux devant Frédéric, la passion de Saint-Preux pour Julie, l’attraction d’Augustin pour Yvonne, ou l’admiration contemplative de Georges pour Alexandre… Ces extraits très célèbres ont façonné notre culture littéraire, et constituent désormais des références pour les écrivains et les lecteurs d’aujourd’hui.
En savoir plus sur Littérature Portes Ouvertes
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Un commentaire sur « La scène de première rencontre »