Dans notre monde toujours davantage pollué d’injonctions à l’efficacité et à la vitesse, dans notre société gangrenée par le bruit et le bavardage, dans nos vies hyperconnectées et saturées d’images, lire Jaccottet fait vraiment du bien. C’est une invitation à un rythme plus lent, à une attitude plus calme, plus observatrice, plus méditative. Je dirais même que Jaccottet devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. Et je vous explique pourquoi.
Qui est Philippe Jaccottet ?
Philippe Jaccottet est né en 1925 à Moudon, dans le canton de Vaud, et mort en 2021 à Grignan, en Drôme provençale — deux lieux à l’écart du tumulte, comme lui. Poète, essayiste et traducteur, il aura traversé le XXe siècle sans jamais hausser la voix, préférant aux éclats les nuances de la lumière et les silences pleins de sens.
Après des études à Lausanne, il s’installe à Paris, puis choisit de vivre à Grignan dès 1953, loin des cercles littéraires parisiens. Là, entre les cyprès et les collines, il mène une vie discrète, dédiée aux mots et aux saisons. Il traduit avec exigence Hölderlin, Rilke, Musil ou encore Mandelstam — des auteurs qui, comme lui, accordent plus d’importance à la justesse qu’à l’éclat.
Entré de son vivant dans la Pléiade (fait rare), Jaccottet est devenu, presque malgré lui, une figure majeure de la poésie contemporaine. Une œuvre modeste en apparence, mais d’une intensité continue — à l’image de sa vie : sans fracas, mais avec une fidélité farouche à la beauté du monde.
« Plus je vieillis, et plus je croîs en ignorance,
plus j’ai vécu, moins je possède et moins je règne. » (p. 154)
Un poète, zéro égo
À l’heure où beaucoup se battent pour « exister » dans les files d’attente numériques de la notoriété, Philippe Jaccottet, lui, aurait volontiers disparu dans le décor — à condition que le décor soit un champ d’herbes sèches en Drôme provençale. Pas d’autoportrait en majesté, pas de manifestes enflammés : il se présentait comme « l’Ignorant », et ce n’était pas un jeu de rôle, mais une posture éthique.
Ne rien affirmer trop fort, ne rien figer, toujours douter — mais douter avec grâce. Il écrivait comme on écoute, traduisait comme on s’efface, et regardait le monde avec cette attention timide qui fait les grandes présences discrètes. Aucune tentation d’écrire son nom en capitales : chez lui, même la lumière arrive en minuscules. Refuser les feux de la rampe, c’était chez lui non pas un caprice, mais une façon de ne pas abîmer ce qu’il tentait d’approcher — le réel, dans ce qu’il a de plus fragile. Résultat : un poète sans ego, mais avec une profondeur qui, elle, ne faisait pas semblant. Et cela fait un bien fou !
« J’aimerais que ces voix se taisent
et que tout aille un peu moins vite,
n’ayant ni force ni délais » (p. 148)
Jaccottet ou l’art d’apprivoiser la mort avec les mots
Pas question chez lui de maquiller la mort en dame élégante ou de la déguiser en refrain rassurant : il la montre crue, sans fard ni langue de bois. La mort chez Jaccottet, c’est parfois le cadavre, avec son horreur froide et muette — un spectacle que beaucoup préfèrent ignorer, mais que lui affronte sans détour. Il n’a pas peur de nommer l’indicible, d’entrer dans la poussière et le silence, quitte à dérouter le lecteur habitué aux consolations faciles. Mais loin de céder au désespoir ou au nihilisme, il installe un rapport singulier, presque tendre, avec cet inévitable qui nous terrasse tous un jour.
« Déjà ce n’est plus lui.
Souffle arraché : méconnaissable.Cadavre : un météore nous est moins lointain.
Qu’on emporte cela. » (p. 458)
Ce qui rend son approche si précieuse, c’est qu’il ne cherche pas à fuir ou à dominer la mort. Il ne brandit pas des discours grandiloquents sur l’au-delà, ni des promesses de renaissance spirituelle. Non, Jaccottet fait le pari de l’acceptation lucide : la mort est là, dans toute sa cruauté, et il faut « faire avec ». C’est un art d’apprivoisement, une manière d’entrer en dialogue avec l’incontrôlable, sans illusion ni colère. Ce n’est pas une victoire, c’est une cohabitation humble, respectueuse, presque méditative.
« Demeure en modèle de patience et de sourire,
tel le soleil dans notre dos encore,
qui éclaire la table, et la page, et les raisins. » (p. 460)
Les recueils Leçons (1978) et Chants d’en bas (1983) incarnent cette posture à merveille. Présentés par le poète lui-même comme des « livres de deuil », ils traversent la douleur, la perte et la disparition sans chercher à les esthétiser de façon hypocrite. Le deuil n’est pas ici un chemin lisse, mais une traversée cahoteuse où les mots cherchent leur place dans le silence. Et c’est précisément dans cette fragilité que réside la beauté sublime de ces textes : ils ne transforment pas la mort en belle image décorative, mais ils nous donnent à voir comment, peu à peu, on peut, sinon s’y habituer, du moins faire avec, dans la pleine conscience de l’instant présent.
Lire Jaccottet, c’est finalement accepter de ralentir, de baisser la garde, d’ouvrir grand les yeux à ce qui fait peur. Et c’est un cadeau : parce que dans ce face-à-face avec la mort, la poésie devient un allié, un compagnon d’ombre qui éclaire sans aveugler, qui accompagne sans juger. Et, surtout, qui nous rappelle que la mort, malgré toute son horreur, peut aussi devenir un lieu d’attention extrême, de beauté tragique, et même — pourquoi pas — de paix.
« Je me redresse avec effort et je regarde :
il y a trois lumières, dirait-on.
Celle du ciel, celle de qui là-haut
s’écoule en moi, s’efface,
et celle dont ma main trace l’ombre sur ma page. » (p. 550)
Le refus du « sententieux phraseur »
La hantise de Philippe Jaccottet, c’est de n’être qu’un « sententieux phraseur ». Aussi, en de très nombreux points de son œuvre, manifeste-t-il sa méfiance envers ses facilités d’écriture, envers les trop belles images, qui ne seraient qu’un leurre, qu’un vernis de rhétorique qui ferait écran à la vérité. En somme, Jaccottet refuse le joli, l’ornemental, le décoratif, et veut accéder au beau, au beau véritable.
« Parler semble alors mensonge, ou pire : lâche
insulte à la douleur, et gaspillage
du peu de temps et de forces qu’il nous reste. » (p. 539)
Plusieurs, Jaccottet manifeste cette méfiance viscérale envers ce qu’on pourrait appeler les “charmes trop évidents” de la langue. Il se détourne des images faciles, des métaphores qui brillent comme des paillettes, mais qui ne tiennent pas le poids du silence, de l’attente, de la vérité nue.
Ce refus du décoratif n’est pas une austérité gratuite, ni un ascétisme de mauvais aloi. C’est au contraire une quête exigeante, celle d’un “beau véritable” : une beauté qui ne cherche pas à impressionner, mais à toucher, à déplier le réel sans l’écraser sous des artifices. Chez Jaccottet, le beau se gagne dans la patience, dans la modestie du regard qui observe sans vouloir posséder, dans la langue qui avance à pas feutrés, qui accepte les hésitations, les blancs, les ombres.
Ainsi, loin des sentiers battus du “joli poème” qui flatte et apaise, Jaccottet invite à un face-à-face plus rude, plus sincère, mais infiniment plus vivant. Il nous pousse à dépasser la surface brillante pour atteindre ce cœur frémissant où réside la vérité profonde du monde. Une vérité qui ne se donne pas en spectacle, mais en murmure, en lumière ténue, en souffle suspendu.
« Et néanmoins je dis encore,
non plus porté par la course du sang, non plus ailé,
hors de tout enchantement,
trahi par tous les magiciens et tous les dieux,
depuis longtemps fui par les nymphes, […] » (p. 573)
Jaccottet ou saisir l’insaisissable
Il y a en somme chez Jaccottet une profonde quête de justesse. Ce qui fascine Jaccottet, ce ne sont pas les grandes scènes dramatiques ou les images spectaculaires, mais ces réalités fragiles, presque évanescentes, qui défient la parole. Nuages légers, souffles d’air, jeux de lumière à peine esquissés — autant de phénomènes qui semblent sur le point de disparaître à tout instant, et pourtant qui tiennent le cœur du monde.
Le poète choisit de s’attarder sur ces détails infimes, qui pourraient paraître insignifiants, comme si la beauté, la vérité, se cachaient justement dans cette fragilité. Ces réalités matérielles ne sont pas traitées comme de simples éléments du décor, mais comme des passerelles vers l’invisible. Sous la plume de Jaccottet, la lumière, le nuage, ou l’air paraissent faire signe vers quelque chose de spirituel, sans que cela ne soit davantage que suggéré, sans que rien ne soit affirmé.
« Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste,
enveloppé dans la chevelure de l’air,
ici, l’égal des feuilles les plus lumineuses,
suspendu à peine moins haut que la buse,
regardant,
écoutant
— et les papillons sont autant de flammes perdues,
les montagnes autant de fumées –,
un instant, d’embrasser le cercle entier du ciel
autour de moi, j’y crois la mort comprise.Je ne vois presque plus rien que la lumière,
les cris d’oiseaux lointains en sont les nœuds,la montagne ?
Légère cendre
au pied du jour. »
Ce poème illustre parfaitement la capacité de Jaccottet à mêler le tangible et le spirituel dans une vision aérienne du monde. Il est une invitation à s’abandonner à l’instant, à cette sensation de fusion avec l’air et le ciel, où l’éphémère touche à l’éternel.
*
Lire Philippe Jaccottet, c’est accepter une pause salutaire dans notre monde pressé, un retour à la lenteur où chaque mot compte, où chaque silence respire. Poète de l’humilité et de la justesse, il nous invite à regarder le monde avec des yeux neufs, à apprivoiser la mort sans faux-semblants, et à goûter la beauté dans les frémissements les plus discrets — nuages, lumières, airs, et même cendres. Sa poésie n’est pas un spectacle flamboyant, mais un murmure patient, un éclat ténu qui éclaire les marges du visible. En délaissant l’ornement pour atteindre le vrai, Jaccottet nous rappelle que la poésie est avant tout une façon d’être au monde, attentive, humble, et pleine d’émerveillement. Alors, lire Jaccottet, ca fait du bien. C’est faire un pas de côté, tendre l’oreille au murmure des choses, et peut-être, à travers ce souffle fragile, toucher un peu d’éternité.
Pour en savoir plus

J’ai eu la chance de contribuer à un manuel publié chez Bréal pour le Baccalauréat 2012, où j’ai rédigé le chapitre consacré à Philippe Jaccottet. J’y ai réuni une dizaine de dissertations qui, je l’espère, apportent un éclairage accessible et intéressant sur cet immense poète. Ce travail peut constituer une bonne porte d’entrée pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leur découverte de son œuvre, sans prétendre en faire le tour. Cela a été ma première publication en tant que chercheur !
En savoir plus sur Littérature Portes Ouvertes
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.





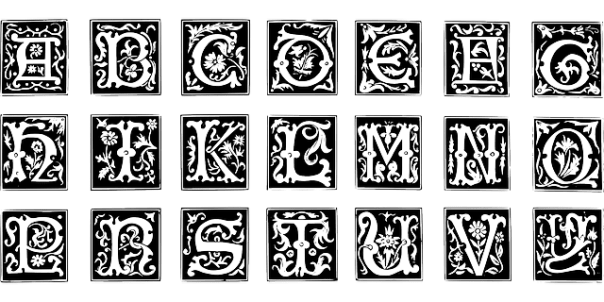



J’ai adoré entendre « les violettes » jouer la musique de la Poésie. Il n’y a qu’un poète pour faire cet exploit, en une seule phrase musicale. Connaissez- vous « Le plâtrier siffleur » de C. Bobin ? 15 minuscules pages, des apparitions …
J’aimeAimé par 1 personne
Je vais regarder ça…
J’aimeJ’aime
Pouvez-vous s’il vous plaît me dire dans quel livre vous avez trouvé ce poème, « Je me redresse avec effort et je regarde :
il y a trois lumières, dirait-on.
Celle du ciel, celle de qui là-haut
s’écoule en moi, s’efface,
et celle dont ma main trace l’ombre sur ma page. » (p. 550)
J’aimeAimé par 1 personne
Le Pléiade des Œuvres complètes de Jaccottet.
J’aimeJ’aime